 Sur les bords du vieux canal, un vestige de l'artisanat chalabrois.
Sur les bords du vieux canal, un vestige de l'artisanat chalabrois.
Cette bâtisse en ruine qui jour après jour a modifié sa silhouette en silence, fut entre 1920 et 1940 l'atelier Jouret, du nom de Louis Jouret, quincailler et épicier sur la place du marché.
Dans le Tome V édité en juillet 2000 par l'association « Il était une fois Chalabre » et sous la plume de Maurice Rouzaud, il apparaît que Louis Jouret, Puivertain d'origine, fabriquait là des manches de couteau en corne avant d'y monter les fameuses lames du Puy-de-Dôme, venues de Thiers. Le délicat assemblage était réalisé dans un local de la Traverse de la Halle grâce au savoir-faire de François, Joseph et Guy Huillet, mais la bâtisse évoquée aujourd'hui se trouve route de Lavelanet, juste au pied des Genêts, après le petit pont de pierre. Ce bâtiment annexe à l'écart du village et pour cause, permettait le recyclage des rebuts après usinage de la corne, activité plutôt incommodante, étant donné l'odeur particulièrement tenace dégagée par le traitement de la matière première : «les déchets de corne de mouton et de bœuf étaient concassés et servaient à faire de la « cornaille », utilisée comme engrais. Une turbine lancée par la force motrice des eaux du canal permettait d'actionner machines et courroies, les vestiges du canal et l'emplacement de la turbine sont encore visibles ».
Les temps changent, la corne autrefois abondante a hélas cédé la place à la chose plastique mais bonne nouvelle, les vieilles pierres fatiguées refont leur vie quelque part sur les hauteurs du vieux Chalabre.
 A l'image des chemins empruntés par les pèlerins faisant route vers St-Jacques de Compostelle, les sentiers du Kercorb ont connu une belle animation lors des récentes journées dédiées au patrimoine. Depuis l'église St-Jean-Baptiste de Sonnac, vers l'église de St-André de Roubichoux ou encore la chapelle du Calvaire à Chalabre, l'on a pu voir se croiser de nombreux promeneurs vantant chacun à leur tour les beautés des sites visités. Des sites aux richesses parfois insoupçonnées mais qui connaissent à l'évidence des fortunes diverses. Il y aura bientôt dix ans, les Compagnons de Roubichoux unissaient leurs efforts pour sauver de l'oubli et redonner sa splendeur d'autrefois à un lieu saint qui n'était plus que ruines. Aujourd'hui et à moins de cent jours de l'an 2000, les compagnons bâtisseurs s'apprêtent à inaugurer un joyau du patrimoine. A peu de distance de là sur le «Mont Calvaire», une petite chapelle poursuit sa lutte contre les éléments et dans l'indifférence quasi générale. Ce lieu délaissé depuis plus de trente années avait bénéficié au printemps 1996 de soins d'un ouvrier spécialisé requis par la municipalité chalabroise et l'ASPAK (association pour la sauvegarde du patrimoine artistique en Kercorb), présidée par Marie-Louise Saddier. Ancien artisan et compagnon du tour de France, Frédéric Paillard s'était employé durant dix mois à restaurer mobilier, statues, toiles, ainsi qu'une partie de la toiture et cela en collaboration avec les employés de la commune.
A l'image des chemins empruntés par les pèlerins faisant route vers St-Jacques de Compostelle, les sentiers du Kercorb ont connu une belle animation lors des récentes journées dédiées au patrimoine. Depuis l'église St-Jean-Baptiste de Sonnac, vers l'église de St-André de Roubichoux ou encore la chapelle du Calvaire à Chalabre, l'on a pu voir se croiser de nombreux promeneurs vantant chacun à leur tour les beautés des sites visités. Des sites aux richesses parfois insoupçonnées mais qui connaissent à l'évidence des fortunes diverses. Il y aura bientôt dix ans, les Compagnons de Roubichoux unissaient leurs efforts pour sauver de l'oubli et redonner sa splendeur d'autrefois à un lieu saint qui n'était plus que ruines. Aujourd'hui et à moins de cent jours de l'an 2000, les compagnons bâtisseurs s'apprêtent à inaugurer un joyau du patrimoine. A peu de distance de là sur le «Mont Calvaire», une petite chapelle poursuit sa lutte contre les éléments et dans l'indifférence quasi générale. Ce lieu délaissé depuis plus de trente années avait bénéficié au printemps 1996 de soins d'un ouvrier spécialisé requis par la municipalité chalabroise et l'ASPAK (association pour la sauvegarde du patrimoine artistique en Kercorb), présidée par Marie-Louise Saddier. Ancien artisan et compagnon du tour de France, Frédéric Paillard s'était employé durant dix mois à restaurer mobilier, statues, toiles, ainsi qu'une partie de la toiture et cela en collaboration avec les employés de la commune.
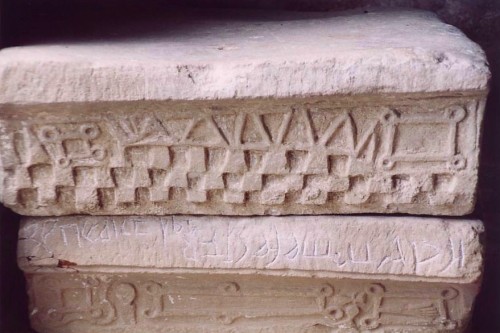
 Jacques Touchet (ici aux côtés de Jean-Luc Bénet) a ainsi permis d'éclairer d'un jour nouveau l'histoire de la chapelle, dont l'existence remontait à 1115, selon les seules sources connues à ce jour et tirées des documents du Prieuré de Notre-Dame-de-Camon.
Jacques Touchet (ici aux côtés de Jean-Luc Bénet) a ainsi permis d'éclairer d'un jour nouveau l'histoire de la chapelle, dont l'existence remontait à 1115, selon les seules sources connues à ce jour et tirées des documents du Prieuré de Notre-Dame-de-Camon.
