L’article mis en ligne avait été publié dans l’Indépendant, édition du dimanche 22 mars 1998.
 Les petits fondeurs avant le départ (Photos archives, Mars 1998).
Les petits fondeurs avant le départ (Photos archives, Mars 1998).
Juste pour le plaisir de courir, nos petits écoliers se retrouvaient dernièrement au coeur de la cité blanquetière, sur la même ligne de départ que leurs camarades des écoles primaires de Limoux et des communes environnantes. Accompagnés par leurs instituteurs, MM. Jean Plauzolles et José Navarro auxquels s’étaient joints plusieurs parents, les jeunes fondeurs chalabrois ont ainsi participé au 9e Cross USEP en compagnie de plus d’un millier de concurrents.

Derniers mètres sur l'allée des Marronniers pour Lionel Martinez et Aurélien Moralès
Transcendés par les multiples encouragements reçus tout au long du parcours, les enfants ont offert une belle image de fraîcheur et de spontanéité. Et lorsqu’ils ont enfin coupé la ligne blanche d’arrivée, nos coureurs de fond étaient bien sûr fatigués, mais tellement heureux d’avoir purement et simplement participé.
Succès sur l’échiquier (Mars 1998)
 Nous adressons de sincères félicitations au citoyen Michel Maugard (photo, Mai 1977) qui vient de remporter à Carcassonne, la Coupe de l’Aude d’échecs.
Nous adressons de sincères félicitations au citoyen Michel Maugard (photo, Mai 1977) qui vient de remporter à Carcassonne, la Coupe de l’Aude d’échecs.
Redoutable avant-centre lorsqu’il portait les couleurs du FC Chalabre, Michel n’était que très rarement mis en échec par les défenses adverses.
Ce sont à présent les diagonales sur grand échiquier qui n’ont plus de secret pour lui, encore bravo Michel !
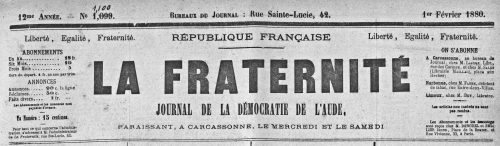
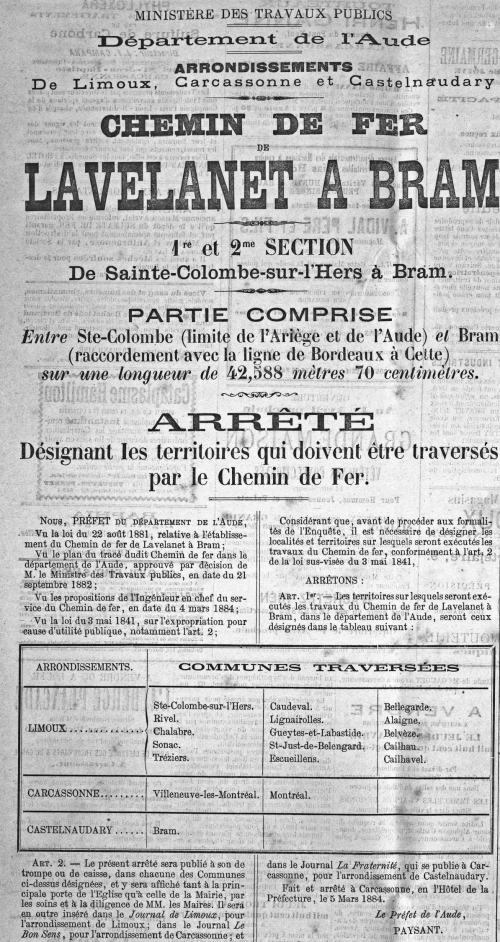
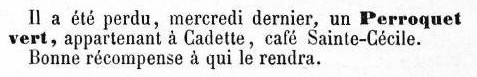
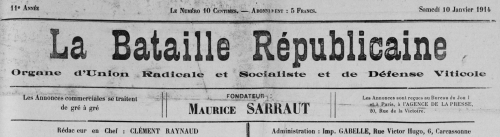
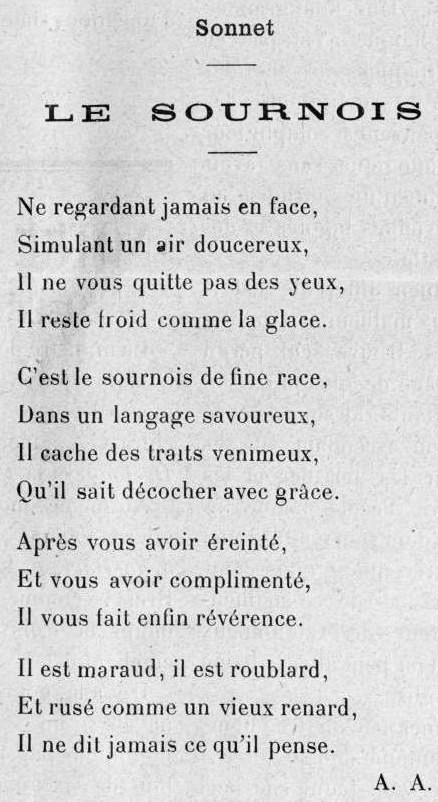
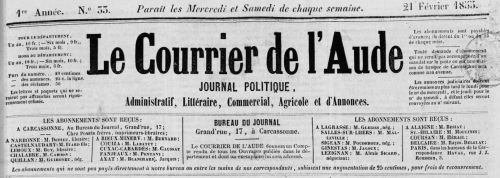
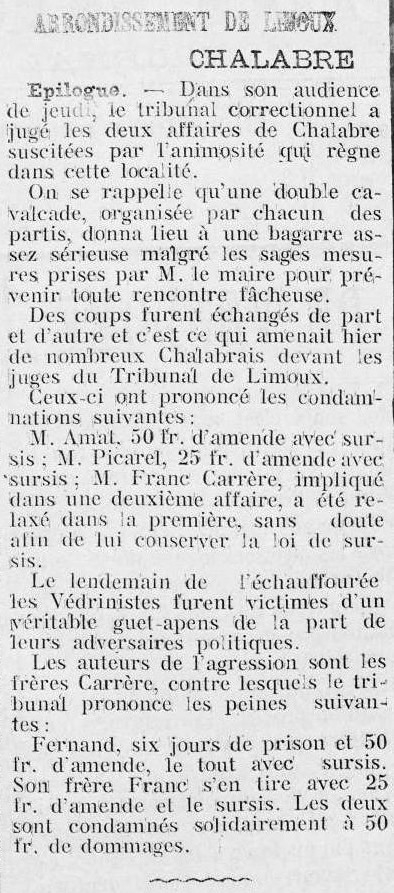
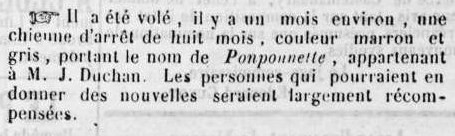
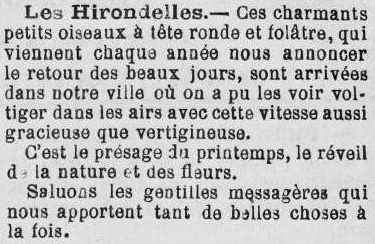
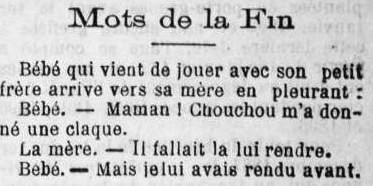
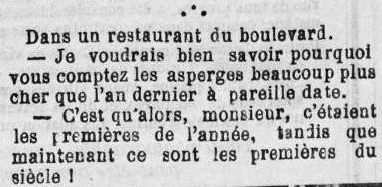

 Les petits footballeurs ont apprécié le cadeau (Photo archives, Mars 1998, de gauche à droite, Aurélien Moralès, Mathieu Bedin, Frédéric Massat, Fabrice Rosich, Terry Rousselet, Betty Sibra, Anthony Rosich, Thomas Walheim).
Les petits footballeurs ont apprécié le cadeau (Photo archives, Mars 1998, de gauche à droite, Aurélien Moralès, Mathieu Bedin, Frédéric Massat, Fabrice Rosich, Terry Rousselet, Betty Sibra, Anthony Rosich, Thomas Walheim).